Disjonction acromio-claviculaire à Bezons


Qu'est ce qu'une disjonction acromio-claviculaire et comment la diagnostiquer ?
Chirurgie de l'épaule à Bezons
Pathologie
Il s’agit d’une luxation entre l’acromion de l’omoplate et l’extrémité distale de la clavicule. Il y a donc une perte de contact entre les surfaces articulaires de la clavicule et de l’omoplate qui fait suite à un traumatisme plus ou moins violent.
Cette pathologie d’origine traumatologique est très fréquente chez les sportifs, quelque soit leur niveau, mais les rugbymen, les judokas, les cyclistes et les motards sont plus souvent touchés.
Il existe des classifications qui permettent d’apprécier le nombre de ligaments atteints et donc d’adapter au mieux la prise en charge thérapeutique. Effectivement, le traitement chirurgical n’est pas systématique.
Disjonction acromio-claviculaire à Bezons
Docteur Poulain spécialiste de l'épaule
Bilan préopératoire ou comment faire le diagnostic
Pour établir un diagnostic lésionnel, l’examen clinique doit être précis ce qui, en urgence, peut être délicat en raison des douleurs du patient.
Une translation de haut en bas de l’extrémité distale de la clavicule (« touche de piano ») est recherchée, signant la rupture du ligament acromio-claviculaire. Une translation d’avant en arrière signe la rupture des ligaments cléïdo-coracoïdiens.
L’effraction de la chape deltoïdienne (clavicule sous la peau) est facilement appréciée.
Le bilan d’imagerie nécessite dans un premier temps une radiographie de l’épaule (de face et de profil) et de l’acromio-claviculaire de face. Ce bilan permet d’éliminer une fracture associée de la glène, de l’apophyse coracoïde, de l’humérus…
Un scanner de l’épaule peut-être utile pour apprécier le déplacement postéro-supérieur de la clavicule. La disjonction peut alors être classée en quatre stades :
- Entorse bénigne du ligament acromio-coracoïdien ;
- Entorse grave du ligament acromio-coracoïdien ;
- Stade 2 + Rupture des ligaments cléïdo-coracoïdiens (conoïde et trapézoïde) ;
- Stade 3 + Effraction de la chape deltoïdienne par la clavicule ;
Prise en charge thérapeutique
Habituellement, les stades 1 et 2 ne nécessitent pas de traitement chirurgical. Les résultats observés après un mois de repos et 6 semaines de rééducation sont généralement très bons. Les rares patients qui ne présentent pas de bons résultats après 6 mois de traitement fonctionnel peuvent bénéficier d’un traitement chirurgical.
Les stades 3 peuvent bénéficier du traitement chirurgical (patient jeune, sportif, activités professionnelles physiques…).
Les stades 4 sont des indications de prise en charge chirurgicale.
En urgence (<3 semaines post-traumatiques), le traitement chirurgical peut se faire à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Cette technique, moins délabrante pour le deltoïde, permet une meilleure récupération (avec un bénéfice esthétique certain…). La technique arthroscopique est dorénavant beaucoup plus plébiscitée par les chirurgiens spécialistes de l’épaule.
Elle comprend une stabilisation horizontale par une broche et une stabilisation verticale par un système de laçage et d’endo-boutons.
La broche de stabilisation horizontale devra être enlevée entre 4 et 6 semaines après la première intervention.
Pour le traitement chirurgical à distance du traumatisme (>6 mois) la technique à « ciel ouvert » est privilégiée. Il est souvent long et fastidieux et ne peut être proposé qu’à certains patients (contre-indiqué en cas de surcharge pondérale).
Pour les prises en charges de ces disjonctions chroniques de nombreuses techniques existent à ciel ouvert : elles consistent à solidariser de façon pérenne l’acromion et la clavicule mais ont des résultats plus aléatoires que lorsque la prise en charge se fait rapidement après le traumatisme (idéalement moins d’un mois).
Risques
Comme pour toute chirurgie articulaire, il existe un risque limité de raideur de l’épaule ou d’infection articulaire. La technique arthroscopique limite très significativement le risque infectieux.
Des problèmes transitoires et réversibles de cicatrisation peuvent apparaître en particulier sur la cicatrice claviculaire lors du traitement arthroscopique.
Vous trouverez dans le paragraphe « Informations générales » les complications rencontrées dans toute chirurgie de l’épaule et non spécifiques à celle de l’acromio-claviculaire.
Suites opératoires
L’hospitalisation se fait en ambulatoire, en chambre seule ou double selon le choix du patient. La sortie le jour même vers le domicile (pas de centre de convalescence à prévoir).
Pendant cette hospitalisation, les soins ainsi que la surveillance sont assurés par l’équipe médicale et paramédicale.
Un kinésithérapeute de la clinique explique au patient avant sa sortie les gestes autorisés, ceux proscrits et quelques mouvements d’auto-rééducation conseillés. Un document contenant des photos est remis au patient le jour de sa sortie pour lui rappeler les exercices à réaliser au domicile.
La sortie de la clinique se fait avec une écharpe qui maintient le membre supérieur opéré en particulier la première nuit. Le lendemain de l’intervention aucune immobilisation n’est nécessaire (pas d’écharpe ni d’attelle).
Pendant les 2 premières semaines, les soins locaux sont effectués à domicile par une infirmière un jour sur deux. Les fils sont résorbables.
Des antalgiques sont prescrits en cas de douleurs.
La consultation avec le chirurgien a lieu environ un mois après l’opération : il apprécie l’état local (cicatrices, œdème), locorégional (souplesse de l’épaule, inflammation) et général (douleur, fièvre, asthénie). C’est lors de cette consultation que l’ablation de la broche de stabilisation horizontale est programmée. Cette ablation se fera au bloc opératoire lors d’une courte hospitalisation de quelques heures à la clinique.
La rééducation pourra ensuite être débutée (en générale 3 fois par semaine) et prolongée jusqu’à récupération d’un niveau fonctionnel satisfaisant (en général 1 mois).
La reprise des activités professionnelles est envisageable entre quelques jours et quelques semaines après l’intervention en fonction des contraintes physiques. La reprise du sport peut s’envisager entre 2 et 4 mois après l’intervention.
Résultats
Cette intervention permet au patient de retrouver des mobilités normales et sans douleur en particulier lors des croisements des membres supérieurs et des mouvements d’abduction de l’épaule. Les activités sportives peuvent être reprises à partir de la quatrième semaine sans contact (jogging, cyclisme,…) et à partir du quatrième mois avec contact (judo, rugby,…).
Un chirurgien spécialisé dans les pathologies du membre supérieur sera votre interlocuteur privilégié pour vous expliquer et adapter au mieux votre prise en charge.
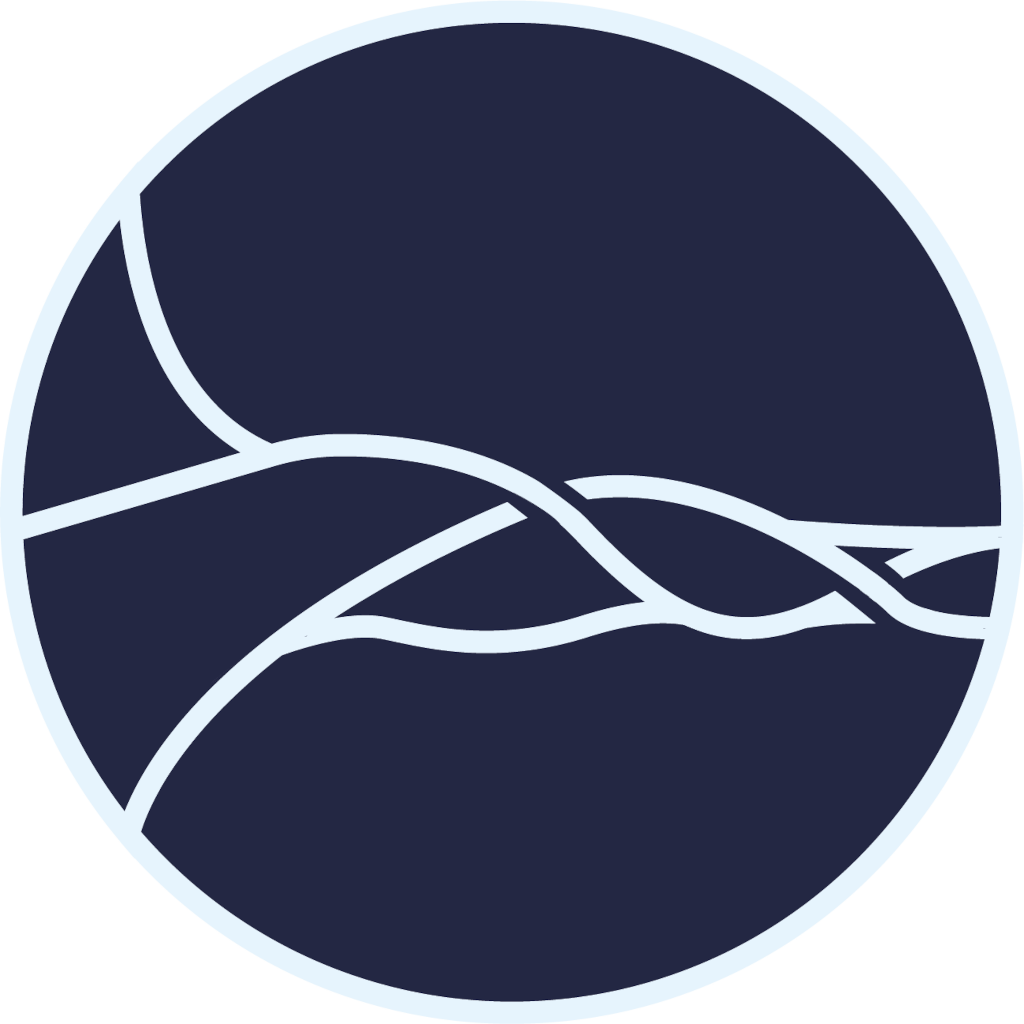
 HEALTHCIE
HEALTHCIE