Fractures de l’épaule à Bezons


Qu'est ce que les traumatismes de l’épaule ?
Chirurgie de l'épaule à Bezons
Les traumatismes de l’épaule peuvent toucher différents éléments anatomiques qui constituent cette articulation.
Les atteintes musculaires touchent le plus souvent le muscle deltoïde qui est le plus gros muscle du membre supérieur : élongation, déchirure (claquage) et guérissent le plus souvent avec de la kinésithérapie et de la patiente.
Les atteintes tendineuses vont de la simple inflammation (tendinopathie) à la rupture de coiffe et sont traitées dans d’autres chapitres.
Les atteintes ligamentaires sont responsables d’entorses plus ou moins graves en fonction du respect ou non de la continuité des ligaments. Les principales entorses de l’épaule sont les disjonctions acromio-claviculaires et les instabilités d’épaule (instabilités gléno-humérales) qui sont traités dans d’autres onglets.
Les fractures peuvent toucher tous les os qui composent l’épaule :
- Fracture d’omoplate
- Fracture de clavicule
- Fracture d’humérus
Fractures de l’épaule à Bezons
Docteur Poulain spécialiste de l'épaule
Fracture d’omoplate
Les fractures d’omoplate font souvent suite à des traumatismes directs assez violents.
On les rencontre le plus souvent après des accidents sportifs (moto-cross, cyclisme, ski…) ou des chutes d’un lieu élevé (travailleurs du bâtiment, défénestration,…).
Elles peuvent toucher différentes zones de l’omoplate.
- Les fractures de l’aile de l’omoplate sont généralement bien tolérées et guérissent spontanément avec du repos (30 à 45 jours). Un traitement chirurgical est rarement nécessaire en cas de déplacement important de la fracture.
- Les fractures de l’acromion (bord antéro-externe de l’omoplate) sont très rares mais de prise en charge difficile. Elles peuvent survenir après un traumatisme mais le plus souvent après la pose d’une prothèse inversée d’épaule. Effectivement, ces prothèses sollicitent le deltoïde qui s’insère en partie sur l’acromion ; en cas d’ostéoporose, on peut observer des fractures de l’acromion quelques semaines ou quelques mois après la pose de ce type de prothèse. La prise en charge chirurgicale est compliquée sur un os porotique et l’abstention est souvent la meilleure solution.
- Les fractures de glène de l’omoplate est parfois traitée chirurgicalement en fonction de la taille du fragment et de son déplacement. Effectivement, la glène étant la partie articulaire de l’omoplate, sa fracture peut être responsable de séquelles douloureuses et fonctionnelles en cas de déplacement trop important.
Idéalement, la prise en charge chirurgicale de ces fractures de glène se fait sous arthroscopie.
Pour toutes ces fractures, un bilan d’imagerie (radiographies + scanner de l’épaule) et l’avis d’un chirurgien spécialisé est recommandé.
Fracture de clavicule
Les fractures de clavicule sont très fréquentes de 7 à 77 ans ! Elles font suite le plus souvent à une chute (vélo, ski,…). Le diagnostic est assez simple car la clavicule est juste sous la peau : le patient décrit l’emplacement de la douleur, le déplacement est visible et la palpation douloureuse. Une radiographie est nécessaire pour confirmer la fracture, la localiser avec précision et apprécier le déplacement.
La prise en charge de ces fractures s’est modifiée depuis quelques années.
Effectivement, si l’abstention thérapeutique était la règle avec une écharpe coude au corps ou la pose d’anneaux en 8, la prise en charge chirurgicale est de plus en plus fréquente ces dernières années.
Le traitement orthopédique (non chirurgical) des fractures de clavicule chez l’enfant et des fractures non déplacées reste indiscutable.
En revanche, les fractures du quart externe de clavicule et les fractures déplacées du tiers moyen sont le plus souvent traitées chirurgicalement afin d’éviter à moyen et long terme un risque de séquelles fonctionnelles et douloureuses. Les fractures déplacées qui consolident avec un chevauchement et un raccourcissement de la clavicule (cal vicieux) sont souvent mal tolérées chez les personnes actives et sportives.
Parfois, ces fractures déplacées ne consolident pas : c’est ce qu’on appelle la pseudarthrose de clavicule. Les pseudarthroses de clavicule nécessitent alors une prise en charge chirurgicale qui est souvent tardive (>3 mois post-traumatique) avec une greffe osseuse prise au dépend de la crête iliaque du bassin.
Traitement chirurgical des fractures de clavicule
L’intervention est pratiquée sous anesthésie générale en ambulatoire. Une incision (entre 8 et 12 cm en fonction de la fracture) est pratiquée le long de la clavicule. Le patient sort de la clinique le jour même avec une écharpe simple qui est conservée 24h. Dès le lendemain le patient débute des exercices d’auto-rééducation et les gestes de la vie courante. Des séances de kinésithérapie sont prescrites en post-opératoire. La conduite du véhicule peut être envisagée au mieux quelques jours après l’intervention. Les soins locaux sont réalisés par un(e) infirmier(e) de ville et les fils sont résorbables.
Une consultation post-opératoire est prévue environ un mois après l’intervention. On discute alors de la reprise des activités professionnelles et sportives.
Les risques de cette intervention sont l’infection et la non-consolidation qui nécessitent une reprise chirurgicale. Heureusement, elles sont très rares.
Une diminution de la sensibilité autour de la cicatrice est parfois décrite par les patients. Elle peut durer quelques mois.
L’ablation du matériel chirurgical est à prévoir environ un an après la première intervention toujours en ambulatoire mais ne nécessite pas de rééducation post-opératoire et une reprise précoce des activités professionnelles.
Fracture de l’humérus
Leur prise en charge varie en fonction de leur type et de leur déplacement.
Les fractures non déplacées seront traitées orthopédiquement (sans chirurgie). Les fractures proches de l’articulation et déplacées seront traitées chirurgicalement. Dans tous les cas, le but est de reprendre un traitement fonctionnnel (auto-rééducation et kinésithérapie) rapidement car ce sont des fractures très enraidissantes.
- Les fractures du trochiter (qui est une tubérosité où s’insèrent trois tendons de la coiffe des rotateurs) tolèrent mal des déplacements même minimes. Des radios et un scanner doivent être réalisés rapidement pour éliminer un déplacement. En cas de déplacement, une chirurgie précoce (idéalement dans les trois premières semaines post-traumatique) doit être envisagée.
- Les fractures céphalo-tubérositaires concernent les tubérosités (où s’insèrent les tendons de la coiffe des rotateurs) mais aussi la tête humérale avec atteinte de la calotte céphalique (partie articulaire de la tête humérale). Une fois de plus, c’est l’importance du déplacement de ces entités anatomiques qui va orienter le choix thérapeutique (immobilisation, rééducation ou chirurgie).
La prise en charge chirurgicale de ces fractures va de la synthèse par des implants chirurgicaux sous arthroscopie jusqu’à la prothèse inversée d’épaule (chez les personnes âgées en particulier) en passant par des ostéosynthèses par plaque vissée ou clous centro-médullaires (enclouage centro-médullaire).
Traitement chirurgical des fractures de l’humérus
Dans la majorité des cas l’intervention a lieu en ambulatoire (sauf pour les prothèses : 48 à 72h d’hospitalisation) et consiste à ramener le fragment en position anatomique (réduction) et à le fixer (ostéosynthèse) pour pouvoir débuter la rééducation rapidement. Parfois, un drain aspiratif est installé pour évacuer l’hématome (drain de redon).
Les fils sont résorbables et les soins pratiqués tous les deux jours par un(e) infirmier(e) de ville. Le but de ces traitements chirurgicaux est de pouvoir débuter les exercices d’auto-rééducation et la kinésithérapie très rapidement (le lendemain de l’intervention) pour éviter un enraidissement de l’articulation.
Une consultation post-opératoire à un mois avec une radio de contrôle permet d’apprécier la cicatrice, les douleurs et la mobilité. La kinésithérapie est prolongée pendant 3 à 6 mois.
La reprise des activités professionnelles se fait après le deuxième mois post-opératoire en fonction des activités et il faut souvent attendre au moins 4 mois pour reprendre le sport.
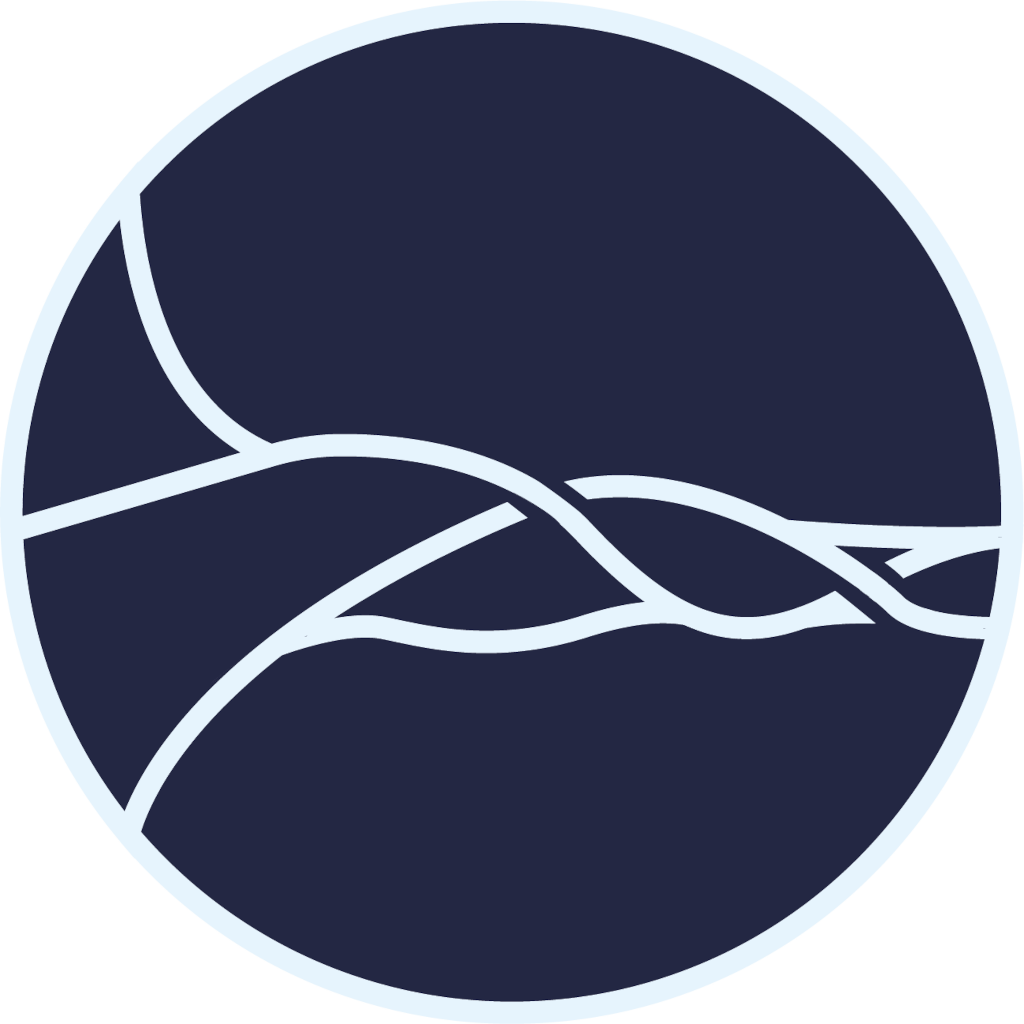
 HEALTHCIE
HEALTHCIE