Luxations récidivantes d’épaule à Bezons


Qu'est ce que les luxations récidivantes d’épaule et comment les diagnostiquer ?
Chirurgie de l'épaule à Bezons
Pathologie
L’épaule douloureuse et instable (luxation d’épaule) est une pathologie du sujet jeune et sportif le plus souvent.
L’épaule se « déboite » après un traumatisme plus ou moins violent.
Le symptôme le plus évocateur est l’épisode de luxation vraie de l’épaule qui correspond à la perte de contact complète mais provisoire des surfaces articulaires de l’épaule (glène de l’omoplate et tête humérale). Cet épisode de luxation est en général très douloureux et nécessite l’intervention d’un tiers pour réduire l’articulation et remettre l’épaule en place.
Mais l’instabilité peut aussi être ressentie par le patient sous forme d’appréhension, de sensation de subluxation (ne nécessitant pas l’intervention d’un tiers) ou seulement de douleurs lors de la réalisation de certains mouvements. Ces mouvements surviennent lorsque le bras est en haut et en arrière (armer du bras).
L’instabilité est le plus souvent antérieure mais elle peut aussi être postérieure voire erecta (exceptionnelle).
Luxations récidivantes d’épaule à Bezons
Docteur Poulain spécialiste de l'épaule
Bilan préopératoire ou Comment faire le diagnostic
Un examen clinique complet par un spécialiste permet d’apprécier le type et l’importance de l’instabilité afin de prescrire les examens complémentaires les plus adaptés et d’éliminer des lésions associées : fracture, atteinte neurologique…
Dans l’instabilité antérieure il faut rechercher des lésions de passage en avant et en bas de la glène ainsi que sur la tête humérale : lésions osseuses et/ou capsulo-ligamentaires qui vont induire un risque de récidive.
Après un examen clinique complet et la réalisation du bilan nécessaire le chirurgien évalue la stratégie thérapeutique la mieux adaptée.
Le bilan d’imagerie nécessite des radiographies de l’ épaule (face 3 rotations, profil de glène de Bernageau).
Pour mettre en évidence des lésions ligamentaires ou labrales (bourrelet glénoïdien), un arthro-scanner est souvent demandé. L’I.R.M. sans injection n’a pas d’intérêt.
Prise en charge thérapeutique
Toute luxation articulaire reste une urgence absolue (moins de 6h). Idéalement la réduction se fait en milieu hospitalier, après réalisation d’une radiographie (éliminant une fracture du trochiter) et d’une analgésie (voire sédation et curarisation si fracture associée). Un médecin remet l’épaule en place (réduction articulaire) grâce à une manœuvre externe connue de tous les urgentistes.
Après une courte immobilisation par une écharpe simple pendant quelques jours (5 à 15j.), une rééducation peut être nécessaire afin de retrouver de bonnes amplitudes articulaires.
La rééducation n’a pas intérêt en terme de stabilisation antéro-inférieure d’une épaule mais elle parfois utile pour retrouver de bonnes mobilités après une luxation d’épaule.
L’abstention thérapeutique est souvent proposée après un épisode unique et isolé d’instabilité.
La chirurgie
En cas d’instabilité récidivante ou d’épaule douloureuse chronique dans un contexte d’instabilité ou de laxité ligamentaire et chez les patients jeunes pratiquant un sport à risque, une intervention chirurgicale peut être proposée.
L’arsenal chirurgical se résume essentiellement à deux techniques :
- La butée osseuse de Latarjet-Patte ;
- La capsuloplastie antéro-inférieure de Bankart ;
L’intervention de Bankart est de moins en moins proposée en raison d’un taux de récidive élevé et reste réservée à des indications bien spécifiques.
La capsuloplastie de Bankart se réalise de manière courante sous arthroscopie alors que le Latarjet, le plus souvent, se fait en « mini-open » et parfois sous arthroscopie.
La technique choisie dépend du patient (âge), du genre (homme/femme), du sport pratiqué (avec ou sans contact, armé-contré) et du niveau (débutant, haut niveau), de l’existence d’une hyperlaxité antérieure et/ou inférieure, d’éventuelles lésions osseuses associées (glène et/ou tête humérale) et d’autres facteurs chirurgicaux.
L’intervention se pratique sous anesthésie générale associée à une technique d’analgésie loco-régionale (bloc inter-scalénique) qui permettent d’endormir l’épaule pendant plusieurs heures après l’intervention.
Des antalgiques par voie générale sont également administrés pour la prise en charge de la douleur post-opératoire.
La RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) permet de réduire considérablement les délais de convalescence.
L’hospitalisation est très courte dans les deux cas.
L’hospitalisation se fait en ambulatoire. L’équipe soignante vous accueille le matin de votre intervention, récolte vos documents administratifs et médicaux (imagerie, bilan sanguin,…), vérifie et complète si besoin votre préparation cutanée. Après l’intervention une collation vous est servie, le pansement chirurgical est remplacé par un pansement imperméable qui vous permettra de prendre une douche le soir même. Le retour au domicile est autorisé le jour même après visite du chirurgien.
Risques
En dehors des risques inhérents à toute chirurgie (hématome, neuro-algodystrophie, infection), on retrouve dans les complications : l’échec et les raideurs postopératoires. L’échec se caractérise par une récidive d’un épisode instable, le plus souvent dans les deux années qui suivent l’intervention.
Les raideurs postopératoires nécessitent un programme de rééducation prolongé et de la balnéothérapie.
Suites opératoires
Le pansement sera à changer par vous-même ou une infirmière à domicile pendant les 2 premières semaines post-opératoires. Les fils sont résorbables.
Des antalgiques (niveau 2) et des anti-inflamatoires vous sont prescrits pour soulager les douleurs initiales.
L’écharpe pour maintenir le bras n’est conservée que jusqu’au lendemain de l’intervention. Après 24h, aucune immobilisation n’est nécessaire.
Des mouvements d’auto-réeducation sont expliqués par l’équipe de kinésithérapeutes de la clinique le jour de l’intervention et doivent être pratiqués quotidiennement par le patient pendant le premier mois. Un document contenant des photos est remis au patient le jour de sa sortie pour lui rappeler les exercices à réaliser au domicile.
Le patient s’habille seul et prend des douches à partir du lendemain de l’intervention. Un arrêt de travail de quelques semaines est souvent prescrit jusqu’à la visite de contrôle.
La consultation de contrôle à un mois avec le chirurgien permet de vérifier la décroissance des douleurs, la qualité des cicatrices, l’absence de raideur anormale.
Un programme de kinésithérapie de quelques semaines est prescrit au rythme de trois séances par semaine. Les patients sont ensuite revus en consultation à 6 mois pour apprécier la bonne évolution.
Résultats
Les stabilisations gléno-humérales ont d’excellents résultats à condition de bien sélectionner les patients pour chacune des indications (les taux de récidives fluctuent entre 1 et 15% en fonction des lésions pré-opératoires et des techniques choisies).
La conduite du véhicule est possible quelques jours après l’intervention.
La reprise des activités professionnelles dépend des contraintes physiques (quelques jours à quelques semaines mais moins de deux mois dans la majorité des cas).
La reprise des activités sportives se fait entre 1 mois (course à pied, cyclisme, renforcement musculaire) et 4 mois (rugby, judo, hand-ball,…).
Pour les sportifs de haut niveau, le retour à la compétition est de 6 mois. Effectivement, même si l’épaule est stable, il persiste longtemps une appréhension lors des contacts et des armés contrés (hand-ball, rugby, …).
Un chirurgien spécialiste de l’épaule saura vous expliquer et vous guider pour choisir la prise en charge la mieux adaptée à votre instabilité d’épaule.
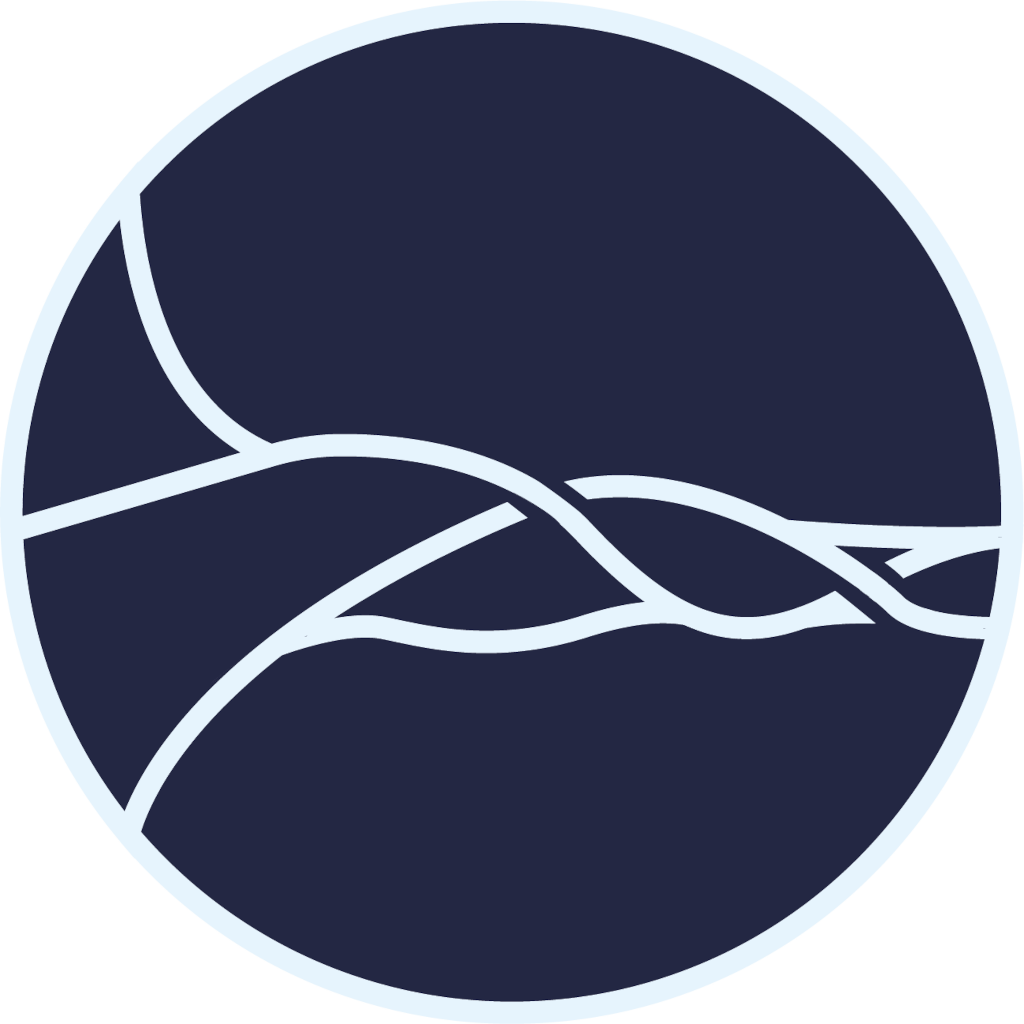
 HEALTHCIE
HEALTHCIE